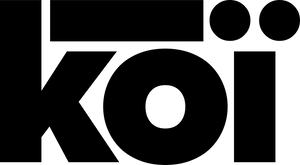Formée à l’école Duperré puis à l’Institut français de la mode, Christine Phung a raflé de nombreuses récompenses (Grand Prix de la Création de la ville de Paris en 2011, ANDAM Fashion Award en 2013, Prix des talents du luxe et de la création en 2018...) tout en faisant ses armes en tant que designer chez Vanessa Bruno, See by Chloé, Baby Dior ou encore Lacoste avant de prendre la direction artistique chez Georges Rech puis de devenir directrice de création pour Leonard. Un CV déjà bien rempli pour cette jeune quarantenaire qui a également créé sa marque éponyme. Elle manie les imprimés graphiques et floraux, la soie et les plissés aussi bien que les blousons teddies. Pour Koï, la créatrice nous parle de son histoire avec le Cambodge et de sa vision de la mode de demain.
[Texte : Julie Hamaïde — Photos : Samuel Kirszenbaum]
Vous avez une anecdote chargée d’histoire à propos de votre nom de famille. Pouvez-vous revenir dessus ?
Je m’appelle Christine Phung, je suis française d’origine cambodgienne. Mon père a fuit les Khmers rouges. C’est à ce moment-là qu’il a dû changer d’identité. Il a donné ses papiers et son nom à son grand frère de dix-huit ans pour lui permettre de quitter le pays sans être enrôlé militairement. Mon père a ensuite pris l’identité d’un voisin qui était mort et qui s’appelait Phung, un nom vietnamien. « Phượng » veut dire phénix, l’oiseau de feu qui renaît de ses cendres, et je trouve l’idée très forte.
Comment avez-vous découvert cette histoire familiale ?
J’y ai toujours eu accès. J’avais déjà remarqué que je ne portais pas le même nom que les autres membres de notre famille qui s’appelle Trinh. On m’a expliqué très vite l’origine de ce nom. Par ailleurs, mes parents étant divorcés, j’étais également la seule Phung dans la famille de ma mère française. Ce nom m’a toujours questionnée, il me rattachait à mon identité asiatique.
Avez-vous grandi dans la culture cambodgienne ?
Pas du tout. J’ai grandi auprès de ma mère et j’allais voir mon père de temps en temps. Cette histoire familiale l’a fragilisé psychologiquement. Il n’a pas pu être pour moi un passeur culturel. Je pense que c’est lié au génocide et à ce qu’il a vu. J’ai lu des récits terribles à ce sujet, des témoignages de gens qui se dénonçaient au sein d’un même village, un fratricide.
Quel a été le déclencheur pour vous intéresser à l’histoire de votre père, de votre famille et du Cambodge ?
Lorsque mon père a changé d’identité, il s’est enfui à Macau. L’autre partie de ma famille a commencé à migrer en France. Personne n’était retourné au Cambodge depuis 1975. À trente ans, j’ai voulu y aller. J’étais la première à rouvrir la porte. Là-bas, il y avait des cousins, un oncle psychiatre à Phnom Penh. C’est un expert de la santé mentale qui a participé au procès des Khmers rouges. Ka Sunbaunat était professeur à la faculté de médecine de Phnom Penh et a monté tout un service de soins de santé mentale pour les enfants des bourreaux et des victimes, où se croisent médecines occidentales et techniques de soin asiatiques. Lorsque j’ai décidé d’aller au Cambodge, je suis allée à sa rencontre. Il a recroisé les infos, m’a expliqué ce qu’il avait vécu. Lui est resté pour reconstruire son pays, c’est un résilient. Ka Sunbaunat a été une figure paternelle. J’avais lu des histoires sur l’adoption spontanée où, après le génocide, beaucoup d’enfants se sont retrouvés sans leurs parents et ont été adoptés par d’autres membres de leurs familles. Cet oncle m’a donc proposé de m’adopter ! Nous avons appelé mon père et il a accepté, c’était très beau.
Cet article est à lire en version intégrale dans Koï #22, disponible en ligne ou en kiosque.